La « dette sociale », ou casse du siècle, justifie depuis 30 ans les politiques austéritaires des gouvernements libéraux. Mais qu’en est-il vraiment ? Dans ce rapport d’information, nous avons enquêté pour comprendre de quoi la « dette sociale » était composée, comment celle-ci est-elle gérée depuis la création de la CADES (Caisse d’amortissement de la dette sociale) par Juppé en 1996. Au programme : des milliards d’euros perdus en taux d’intérêts versés aux banques et autres créanciers privés, des milliards d’euros volés des caisses de la sécurité sociale pour financer les cadeaux fiscaux et sociaux faits aux grandes entreprises et au patronat… en somme, des milliards d’euros volés à notre système social. Retrouvez mon intervention à la tribune, mon avant propos et le rapport en intégralité !
avant-propos
La jonction entre l’idéologie du risque privé et la financiarisation des
activités économiques s’opère dans des outils concrets, à l’instar de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), objet du présent rapport. Cet outil d’économie politique s’inscrit dans la longue histoire des ingénieries conservatrices visant la mise en marché expiatoire de la dette. Du cantonnement Poincaré (1922) au cantonnement Juppé (1996) en passant par le cantonnement Chirac (1986), tous ont extrait une fraction de dette de ses circuits ordinaires pour « l’afficher » et ériger
son remboursement en priorité nationale. Le cantonnement de la dette s’est donc présenté comme la solution incontournable au problème du « trou de la sécu », dont on ne voit guère à quoi il fait référence, puisque les déficits des différentes caisses sont exclusivement dus aux ponctions de l’État dans les recettes, via les exonérations et les charges indues.
Mais alors que cette caisse devait disparaître au bout de treize ans, voici
qu’elle fête son vingt-huitième anniversaire. Cette pérennité étonnante et l’indigence des débats qui ont entouré sa prorogation, puis les transferts incessants de nouvelles charges, ont intrigué les députés de tous les groupes parlementaires représentés à la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Mecss). Avec Stéphanie Rist, nous avons donc conduit de nombreuses auditions, pour restituer l’histoire très (trop) discrète de la Cades, son fonctionnement, ses prérogatives et les relations de pouvoir qu’elle instaure. La
direction de la Cades, des administrateurs de la sécurité sociale, les organisations syndicales représentatives ou encore des enseignants-chercheurs sont venus éclairer nos analyses. Les travaux étaient donc fort avancés lorsque la XVIe législature de l’Assemblée nationale a vécu sa dissolution-surprise.
Pour rattraper le retard calendaire et respecter les engagements
d’information du grand public, le bureau de la commission des affaires sociales a accepté que nous transformions ce rapport en mission d’information. Il s’agissait donc d’éclairer les discussions budgétaires en cours autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Finalement, le rapport est publié alors que les discussions budgétaires n’ont toujours pas démarré et que le PLFSS demeure
retenu dans un bureau ministériel quelconque. Mais, quoiqu’il en soit, notre rapport montre que des parlementaires sont en capacité de s’accorder sur des faits économiques, de restituer la nature d’une controverse sans abdiquer leurs préférences politiques. Bref, il témoigne d’un besoin de discuter librement les options économiques du pays et du refus de toute pensée unique en la matière.
Car le jugement de principe, de méthode et d’opportunité que porte chaque rapporteur sur la Cades diffère. À mes yeux, l’ordonnance fondatrice de la Cades a engagé un dangereux tête-à-queue. Elle acte le renoncement de la puissance publique à augmenter les cotisations destinées à la sécurité sociale ou à accorder un prêt de la Caisse des dépôts et consignations pour couvrir les dépenses nécessaires.
À la place, une « dette sociale » est construite de toutes pièces en accumulant des déficits, ultérieurement transférés à une caisse dédiée. Celle-ci rembourse intégralement la « dette sociale » – au lieu de la faire rouler, comme la dette publique. D’où des frais exorbitants de commission et de remboursement du principal. En ce sens, il n’y a pas de « fardeau intergénérationnel », mais un rapport de classe : les contribuables (donc essentiellement, en proportion de leurs revenus,
les classes populaires et moyennes) versent des intérêts aux créanciers (les détenteurs de hauts revenus, qui placent ainsi l’argent que les contre-réformes fiscales leur ont restitué ces dernières années). Les enfants d’ouvriers et d’employés paieront demain des intérêts aux enfants de rentiers.
Et ils s’en acquittent notamment par le biais de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale (CRDS), c’est-à-dire un impôt, doublement injuste. D’abord, il est proportionnel, car il frappe à 0,5 % quel que soit le niveau de revenu, les riches comme les pauvres. Ensuite, il dispose d’une assiette antisociale, car il s’applique à tous les revenus, y compris les pensions de retraite ou d’invalidité. Chaque prolongation de la durée de vie de la Cades revient à une hausse d’impôts sur les ménages, puisqu’ils s’acquitteront plus longtemps de la CRDS qui lui est liée et n’expirera qu’avec elle. En somme, les victimes du démantèlement de la sécurité sociale subissent à la fois les déremboursements… et l’obligation de rembourser une dette délibérément creusée. Cette manœuvre culpabilise les ayants droit par une taxe, en épargnant tout relèvement des taux de cotisation aux grands monopoles ou aux hauts salaires.
Comme toute politique de financiarisation, celle-ci fait des gagnants… dont le profil demeure inconnu de la Cades elle-même. Mais le volume net d’intérêts et de commission versé depuis la création de la Cades excède 75 milliards d’euros – des sommes qui n’auraient jamais existé en branchant ce circuit de financement sur la sécurité sociale. Cela représente sept années de déficit de la sécurité sociale ! La finance vit au-dessus de nos moyens – mais à nos frais – et ce rapport constitue donc l’anatomie d’une financiarisation critiquable.
Face à ce constat, que faire ?
Premièrement, tenir bon sur les principes. La Cades et les opérations qui
l’entourent ont un objectif principalement idéologique, celui de « retourner la dette sociale » [Isabelle Astier, Les nouvelles règles du social, Presses Universitaires de France, 2007.]. Depuis 1945, les États sociaux proposaient un contrat social impliquant qu’ils protègent les citoyens des risques de la vie : ils avaient ainsi une « dette sociale » à l’égard des accidentés de la vie. La contre-révolution conservatrice des années 1980 retourne la redevabilité de l’individu à l’égard de l’État en exigeant des
preuves répétées d’adhésion. Je ne l’accepte pas : c’est la puissance publique qui entretient une dette à l’égard des citoyens qui naissent, grandissent et travaillent en son sein [Robert Castel et Jean-François Laé, Le Revenu minimum d’insertion. Une dette sociale, Paris, L’Harmattan, 1992]
Deuxièmement, refuser tout processus financiarisé dans la sécurité sociale, ce grand outil de production économique (de soins, de prestations, d’investissements dans les qualifications…) qui repose sur le couple subvention-cotisation plutôt que sur le couple intérêt-emprunt. En effet, la note finale est toujours supérieure aux prévisions initiales. Et, surtout, elle déplace les lieux de décision vers les marchés financiers, érigés en juges des politiques publiques par le biais des taux d’intérêt acceptés ou refusés.
Troisièmement, conséquence logique du deuxième point, accroître les
ressources de la sécurité sociale afin d’éviter toute constitution de dette, plutôt que d’inventer des impôts injustes censés l’éponger a posteriori. Les sommes levées par la CRDS pour rembourser la dette mériteraient d’être réinjectées directement dans la sécurité sociale. Les marges de manœuvre sont là : à titre d’exemple, depuis 2017, la part des rémunérations du travail dans la valeur ajoutée a reculé de 2 points. Cela
représente 28 milliards d’euros par an, exclusivement dus à sept ans de compression salariale. De même, les exemptions d’assiette sur des revenus non-salariaux, comme la prime « Macron », coûtent près de 10 milliards d’euros par an aux comptes de la sécurité sociale.
Quatrièmement, le rachat et la réintégration des engagements de la Cades dans le budget de l’État, en démarrant par cette charge indue qu’a constitué la « dette covid-19 », soit la facture du chômage partiel ou des congés parentaux décidés par l’État et imputés à la sécurité sociale. Un tel mouvement permettrait de faire rouler la dette plutôt que de sabrer dans les comptes sociaux au nom d’un hypothétique remboursement du principal.
Cinquièmement, limiter les ressources allouées à la Cades. Chaque année, plus de 20 milliards d’euros de recettes s’y engouffrent – le double du déficit annuel de la sécurité sociale ! Dans un esprit de grande modération, on pourrait n’y allouer que la CRDS, et récupérer les 10 milliards levés par le biais de la CSG et du Fonds de réserve pour les retraites vers la sécurité sociale. De quoi ramener les comptes,
en un seul mouvement, à l’équilibre ou à l’excédent. De plus, le financement ainsi étalé pourrait reposer sur une fiscalité progressive, mettant à contribution les grandes fortunes, plutôt que l’allocation de rentrée scolaire ou l’aide personnalisée au logement des plus précaires.
Puisque la Cades est un outil indexé sur les appétits du capital financier, au détriment de la justice sociale, fiscale et sanitaire, ce rapport est à mes yeux un plaidoyer pour le retour à une sécurité sociale intégrale, autonome dans ses ressources et gérée par les travailleurs eux-mêmes
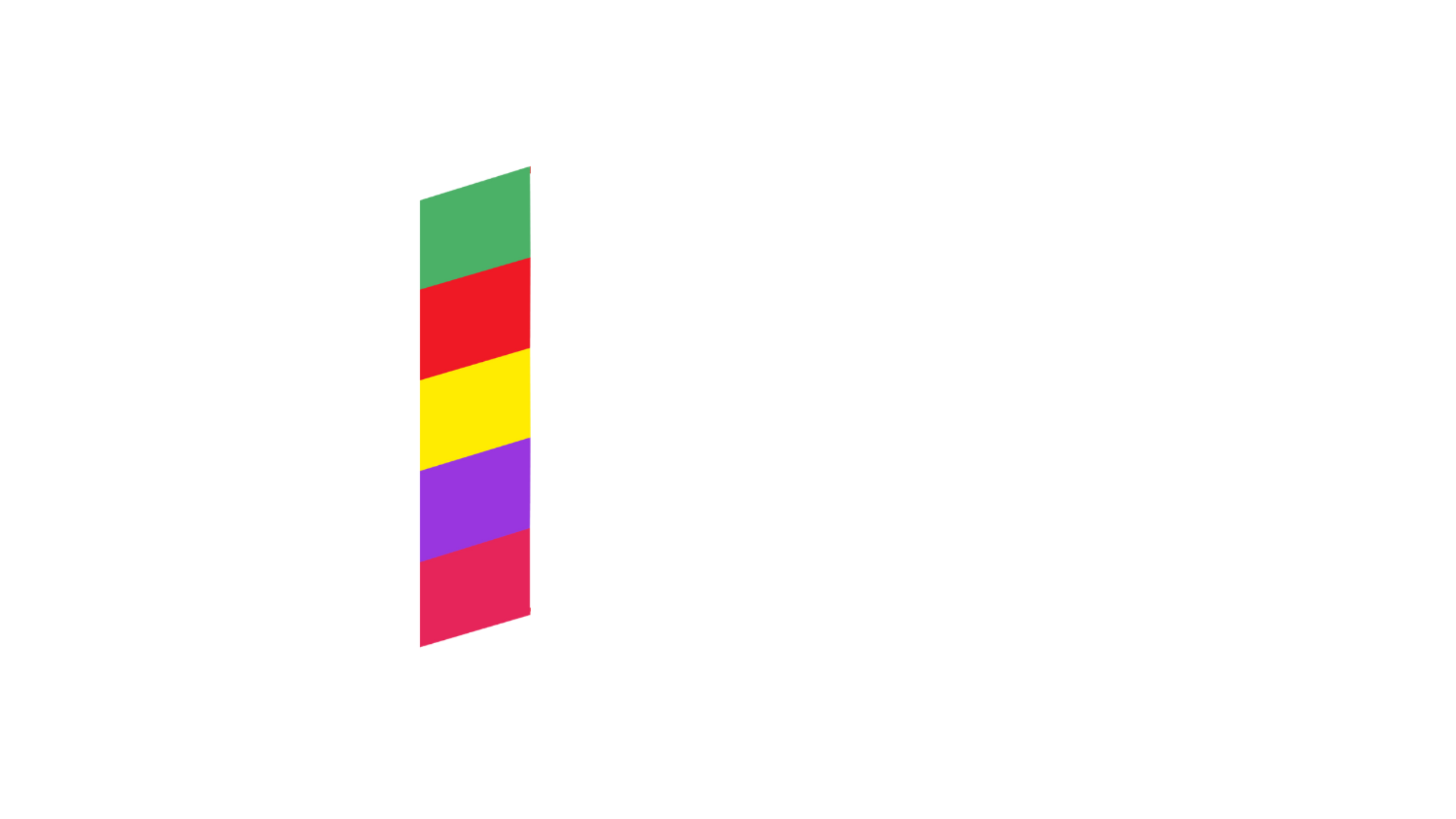
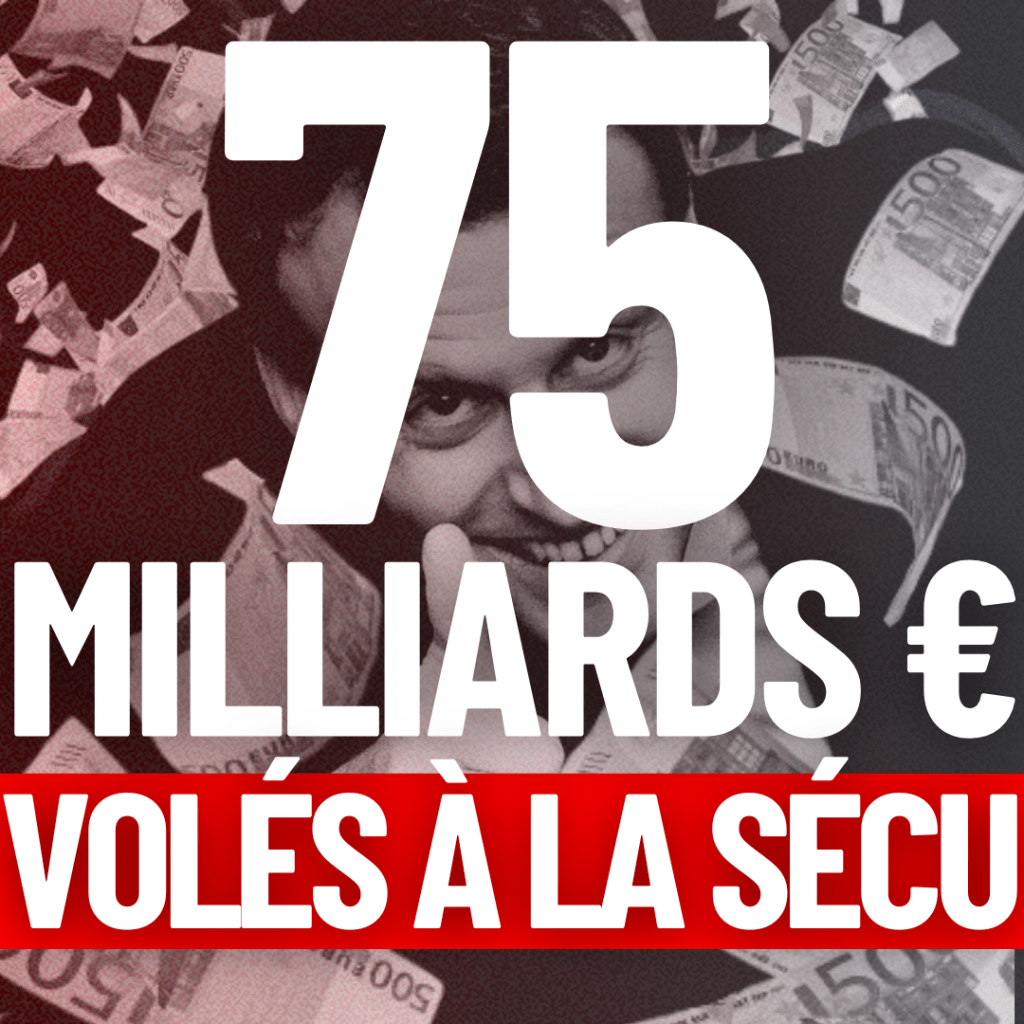
Laisser un commentaire